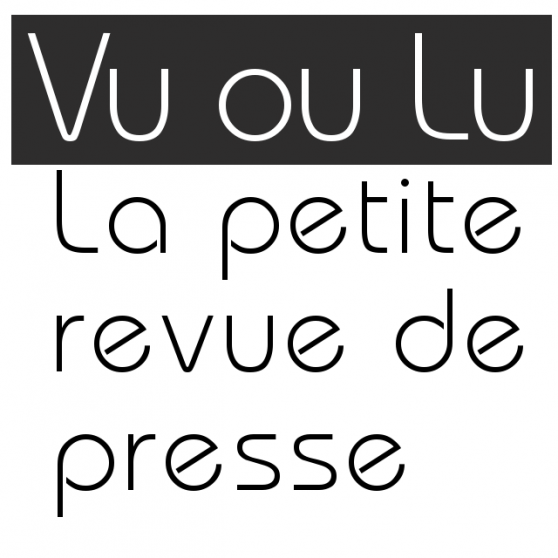Conflictualité et dynamique démocratique : l’action publique au défi des mobilisations collectives
Conflictualité et dynamique démocratique : l’action publique au défi des mobilisations collectives
La concertation connaît aujourd’hui des désenchantements. Est-ce la fin d’un modèle démocratique ?
Auteur : Catherine FORET, géographe et sociologue Article écrit dans la revue M3 n°6 sous le titre « Mobilisations citoyennes : faire avec les conflits » Indifférents, désenchantés, les citoyens ? L’expérience des concertations classiques pourrait le laisser croire. Et pourtant, ils sont prêts à inventer de nouvelles manières de prendre la parole publique, dans la bonne ou la très mauvaise humeur. Et s’il y avait dans ces mouvements éruptifs matière à apprentissage pour l’action publique ?Un certain désenchantement se fait jour, en France, vis-à-vis des dispositifs de concertation mis en place par les pouvoirs publics pour inviter les citoyens à donner leur avis sur les projets qui les concernent. On aurait tort de croire, pourtant, que les critiques en cours signent la fin d’un certain idéal démocratique. L’attente de reconnaissance politique demeure élevée dans le pays, et l’activité citoyenne entre les élections n’a peut-être jamais été aussi fort. Mais elle prend souvent des formes protestataires ou conflictuelles, qui interrogent les cadres balisés de la concertation institutionnelle.
On le voit notamment avec la montée en puissance des mouvements en faveur du « pouvoir d’agir » des citoyens. Des individus, rassemblés dans des groupes plus ou moins formalisés, s’emploient à contester des décisions qu’ils estiment injustes — y compris lorsque ces dernières ont fait l’objet de démarches de consultation ou de débat public. Les institutions en charge de la gestion du bien public se trouvent relativement déstabilisées face à ces mobilisations, qui renouent avec une approche de la démocratie plus conflictuelle que consensuelle. Comment gérer ces revendications en légitimité, qui s’interposent entre le pouvoir des représentants élus et celui accordé aux instances officielles de concertation ?
De l’imprévisible comme catégorie du politique
Un fait mérite d’être souligné, à propos de ces mobilisations et des conflits qu’elles ouvrent dans l’espace public : bien souvent, ces événements surprennent les instances élues ou techniques qu’ils prennent pour cible. Il n’y a là rien d’anecdotique. On peut en effet voir cette dimension irruptive de la conflictualité citoyenne comme l’une des caractéristiques intrinsèques de l’activité politique en démocratie. L’imprévisible, en la matière, ne serait que la manifestation du « souffle » dont parle Jean-Luc Nancy (Vérité de la démocratie, Galilée, 2008) lorsqu’il explique que « la démocratie est esprit avant d’être forme, institution, régime politique ou social ». Esprit, c’est-à-dire « souffle », « désir », expression de la « puissance d’être » d’un « sujet maître de ses représentations, volitions et décisions ». Jacques Rancière (La mésentente, Galilée, 1995) le dit autrement, en soulignant combien la mésentente est au cœur de l’activité politique : celle-ci ne serait effective que lorsque se trouve « interrompu » le cours des choses qui semblaient jusqu’alors aller de soi.
Il est dès lors intéressant de se pencher sur les formes que prennent les manifestations de l’inattendu, dans ce genre de conflits. Elles sont nombreuses. Sur le plan temporel d’abord, on notera que ces situations provoquent souvent le bousculement des agendas institutionnels, les acteurs protestataires imposant aux élus et aux techniciens un temps et un rythme qui leur sont propres.
Des personnages inédits
L’imprévisible tient aussi à la nature inédite des sujets collectifs qui portent ces conflits. Ces moments font en effet apparaître de nouveaux personnages publics. Soit qu’ils n’aient jamais pris part à un quelconque engagement citoyen, soit qu’ils soient « inorganisés », agrégés librement en collectifs informels, les protestataires en question dérangent non seulement à cause du bruit qu’ils font sur la place publique, mais aussi parce qu’ils sont inconnus, mal identifiés. Le trouble introduit par ces auto-proclamations citoyennes fait en effet écho à la labilité identitaire propre à nos sociétés contemporaines : les institutions interpellées se trouvent face à des personnes sans qualité, des « engagés affranchis », comme dit Jacques Ion, « qui ne se sentent pas affiliés à quelque groupe d’appartenance que ce soit, ou du moins dont l’engagement se fait indépendamment de ces possibles appartenances » (S’engager dans une société d’individus, Armand Colin 2012), et pas nécessairement sur la longue durée.
Autre caractéristique de ces situations : la mise en avant d’objets de litige qui n’avaient pas été anticipés par les pouvoirs publics. On voit là des citoyens se mêler de problèmes dont l’importance avait été minorée, ou que les élus souhaitaient éviter de mettre en discussion. Montent alors dans le débat public des questions que personne ne posait. Ce qui ne faisait pas problème jusqu’ici le devient.
Des « situations anormales de communication ».
Mais c’est aussi sur le plan formel que se joue l’imprévu dans ces conflits, à travers l’inventivité des actes et des paroles proférées par les citoyens protestataires. Loin de se cantonner, en effet, au langage technique en usage dans les mondes institutionnels, ceux-ci vont user simultanément ou successivement de toutes sortes de registres pour dire le tort qui leur est fait, sur la scène de débat qu’ils ont réussi à constituer à travers leur apparition initiale. Ils vont alterner la modération et les coups de force, le spectaculaire ou l’outrancier, pour trouver un écho public (dans les médias notamment) et construire ainsi leur légitimité. Tout le défi consistant pour eux à passer du bruit à la parole, autrement dit à « faire entendre comme discours » ce qui n’était entendu jusque-là que comme « désordre de la révolte ». Pour cela, l’expérience montre qu’il ne suffit pas de mimer le langage de l’autre. La scène politique en effet, nous rappelle Jacques Rancière, « ne saurait s‘identifier à un modèle de communication entre partenaires constitués, sur des objets ou des fins appartenant à un langage commun ». L’interlocution politique s’opère au contraire dans « des situations anormales de communication », qui requièrent de la part des citoyens mobilisés un véritable travail réflexif, rhétorique et créatif. On voit celui-ci à l’œuvre dans le détail des tracts, communiqués de presse, interventions qu’ils organisent dans l’espace public, qui vont enchaîner argumentations rationnelles et recours à l’humour, la provocation, l’irrévérence ou les métaphores poétiques… Autant d’armes des acteurs faibles, de « langages minoritaires », comme dit Gilles Deleuze, qui vont permettre de déterritorialiser le conflit et d’échapper à une identité assignée (Dialogues, Gilles Deleuze, Claire Parnet, Flammarion, 1996).
Lucidité, élasticité, pragmatisme
Ce que nous montre la multiplication de ces conflits autour de la chose publique, c’est le décalage entre ces formes de mobilisation et le mode d’échange attendu sur les scènes des dispositifs institutionnalisés de concertation. C’est aussi la difficulté croissante des tenants du pouvoir à tenir en lisière du jeu politique ces « porteurs de cause » qui surgissent sans cesse dans le paysage selon Philippe Dujardin (lire les travaux de Philippe Dujardin sur la gouvernance publiés sur www.millenaire3.com).
Un immense défi est ainsi lancé aux autorités publiques soucieuses de co-construire leurs politiques avec les citoyens. On citera trois enjeux sur lesquels il faudrait avancer, pour relever ce défi.
1/ L’enjeu de lucidité.
En premier lieu, il faut prendre la mesure du changement qui travaille en profondeur « sociétés d’individus », comprendre que ces formes d’action collective (spontanées, issues de la base…) ne sont pas prêtes de s’épuiser. Elles sont en effet en phase avec notre temps, qui fait advenir des citoyens plus autonomes — auxquels les outils numériques fournissent de surcroît « des ressources considérables de publicisation et d’échanges de points de vue », selon Hélène Hatzfeld (Les légitimités ordinaires. Au nom de quoi devrions-nous nous taire ? L’Harmattan/ADELS 2011) Les pouvoirs publics devront de plus en plus faire avec l’imprévisible en la matière, et considérer ces mobilisations, dès lors qu’elles tiennent à distance la violence physique, comme mode légitime d’expression politique. Cela implique « déchirer le voile de (la) non-représentativité » supposée de certains groupes de citoyens — comme le préconisait déjà Michel Anselme, dans un texte toujours d’actualité. (Institutions, associations d’habitants et espace public : la représentativité introuvable, in : Du bruit à la parole, La scène politique des cités, Editions de l’Aube). Mener un constant « travail de repérage du vif », être « attentif aux groupes en ascension » : telle est la condition pour voir effectivement apparaître de « nouveaux porte-parole de la vie des quartiers », des collectifs puisant leurs forces dans des groupes vivaces de la société. La lucidité doit aussi consister à voir le conflit comme un événement normal de la vie collective, qui contribue à l’invention de nouvelles normes communes. Il faudrait de ce point de vue prêter davantage attention aux effets que les mobilisations conflictuelles produisent sur l’action publique ; effets dont la force démonstrative ne passe pas inaperçue de l’ensemble de la population ; et qui « travaillent » les agents des institutions, confrontés à l’irruption du politique sur la scène technique qu’ils sont censés gérer.
2/ L’enjeu d’élasticité.
Mettant en avant les vertus constructives du conflit, Georg Simmel expliquait au début du XXème siècle ( Le conflit, réédition Circé poche 2003) que sont toujours à l’œuvre dans les situations antagoniques des forces de dissociation et des forces d’unification. Et il insistait sur l’importance de « l’élasticité de la forme sociale » qui permet à certaines institutions de résister aux risques de rupture que fait courir l’expression des dissidences — voire même d’en faire des facteurs d’innovation — là où des organisations « plus rigides ou plus dogmatiques » n’y parviennent pas. Il y a certainement là un point majeur à réfléchir, en lien avec la fluidité accrue de nos sociétés contemporaines et avec l’instabilité intrinsèque du pouvoir en démocratie. Peuvent s’avérer précieux, en la matière, les travaux de sciences humaines sur les activités de négociation, de conciliation ou de recherche de compromis — qu’il convient de distinguer de celles à l’œuvre dans les pratiques consensuelles.
3 / L’enjeu de pragmatisme.
La remise en question de plus en plus fréquente, par des citoyens ordinaires, de la légitimité des savoirs techniques et centralisés, autant que le pragmatisme dont font preuve les militants d’aujourd’hui, conduit aussi à insister, avec Bruno Latour, sur le fait que la vérité se révèle par l’expérience. Dans sa préface à l’ouvrage de Jacques Lolive, Les contestations du TGV Méditerranée (Paris L’Harmattan) celui-ci plaidait en 1999 pour que les collectivités locales et administrations publiques se donnent les moyens de tirer les enseignements des épreuves que subissent en permanence leurs projets, grâce à des process inspirés des sciences expérimentales :« Il faut (…) imaginer un pouvoir nouveau, qui ne se définisse ni par son savoir, ni par son aptitude à trancher, mais par sa capacité à suivre les expériences en cours et à estimer la qualité de leur apprentissage, une mauvaise expérience n’étant pas celle qui échoue, mais celle dont on n’apprend rien pour la suivante. Une bonne expérience à l’inverse est celle dont les épreuves viennent très tôt mettre en péril les évidences qui servaient à définir le projet. » Considérer les situations conflictuelles auxquelles l’action publique se trouve confrontée comme des épreuves collectives, dont il convient de « documenter avec obstination l’apprentissage » : telle pourrait être l’une des pistes à explorer pour mieux accueillir les initiatives et les savoirs citoyens dans l’élaboration des politiques publiques.