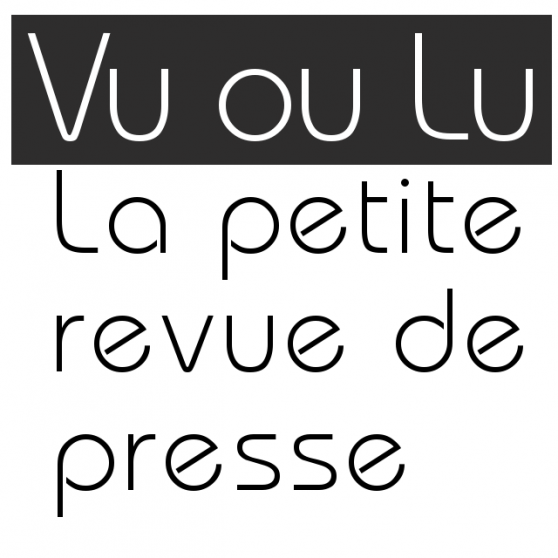La politique de la ville, laboratoire des transformations du pouvoir,
La politique de la ville, laboratoire des transformations du pouvoir,
entretien avec Renaud Epstein
En quoi consiste la politique de la ville ? Quels en sont les objectifs et les principaux instruments ?
Il est plus aisé de la définir par ses cibles – à savoir les grands ensembles d’habitat social des périphéries urbaines marqués par de fortes concentrations de pauvreté, de précarité et des minorités visibles – que par ses objectifs. D’abord parce que la politique de la ville réunit un vaste ensemble de dispositifs, de programmes et d’actions couvrant la quasi-totalité des secteurs de l’action publique. De ce fait, ses objectifs sont multiples. Ensuite parce que ces objectifs ont régulièrement évolué au cours des trente dernières années, au gré des transformations socio-urbaines et de la dégradation continue de la situation des quartiers populaires, de la redistribution des pouvoirs entre institutions publiques et plus encore en fonction des alternances politiques et de l’évolution des représentations de ces quartiers. Enfin et surtout parce que la politique de la ville s’est longtemps organisée dans une logique remontante. Son contenu était défini par les acteurs locaux, ce qui faisait que les objectifs poursuivis pouvaient varier en fonction des villes.
Quelles en ont été les grandes inflexions depuis son lancement ?
On peut distinguer trois grandes périodes. Dans les années 1980, il s’agit d’une politique expérimentale de développement social des quartiers, qui cherche à mobiliser et à faire dialoguer les forces vives de ces quartiers et les agents des services publics qui y travaillent. La décennie suivante est celle de l’institutionnalisation et de la professionnalisation. La politique de la ville devient alors une politique nationale, portée par un ministre et des sous-préfets « Ville » à qui il revient d’impliquer toutes les administrations et les collectivités dans une politique globale de lutte contre l’exclusion socio-urbaine. La loi Borloo, votée en août 2003, marque l’ouverture d’une troisième période. La primauté a alors été donnée à la transformation du cadre bâti, au travers d’un vaste programme de démolition-reconstruction qui devait, en organisant la banalisation urbaine des quartiers visés, rétablir une mixité sociale parée de toutes les vertus. Ce rabattement sur une approche aménageuse correspond à une rupture dans l’histoire la politique de la ville, qui avait toujours cherché à articuler trois dimensions : l’urbain, le social et la prévention de la délinquance. La loi pour la ville et la cohésion urbaine de François Lamy correspond à une tentative de synthèse entre ces trois grandes périodes.
Vous défendez la thèse forte selon laquelle la politique de la ville, et plus particulièrement son volet de « rénovation urbaine » a constitué un laboratoire du redéploiement de l’action publique étatique sur les territoires. En quoi a consisté exactement cette reconfiguration ?
Cette fonction de laboratoire est explicitement revendiquée par les acteurs de la politique de la ville. Pour les élus et les hauts fonctionnaires réformateurs qui sont à l’origine de cette politique, les quartiers populaires avaient vocation à servir de banc d’essai pour un nouveau mode de gouvernement des territoires. Ils devaient prouver la fertilité d’une pratique fondée sur l’approche globale, le partenariat entre État et collectivités locales, la participation des habitants et l’évaluation. Cette fonction modernisatrice s’est prolongée dans la décennie 1990, au cours de laquelle la politique de la ville a cherché à organiser la territorialisation de toutes les politiques publiques, en prenant appui sur le triptyque instrumental diagnostic-projet-contrat. Enfin, on peut voir dans le programme national de rénovation urbaine le prototype d’un nouveau mode d’intervention dans les territoires d’un État reconfiguré par l’Acte II de la décentralisation, la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) et la Révision générale des politiques publiques (RGPP). Sous l’effet de ces réformes néo-managériales, l’État s’est retiré de la cogestion territoriale, déléguant aux élus locaux l’entière responsabilité de la mise en œuvre et de la mise en cohérence de ses programmes. Mais ce retrait s’accompagne paradoxalement d’un retour de l’État, appuyé sur des instruments disciplinaires qui lui permettent d’orienter à distance des politiques menées par des villes autonomes : allocation concurrentielle des budgets par le biais d’appels à projets, diffusion de normes et de modèles par le biais des « bonnes pratiques », des benchmarks (étalonnage de performances qui constitue de plus en plus un mode de gouvernement feutré) et des consultants, pilotage par les indicateurs…
Quel regard portez-vous sur la participation des habitants dans les opérations de rénovation urbaine ? Voyez-vous des pistes pour rendre l’aménagement de l’espace urbain davantage démocratique ?
Les habitants ont été tenus à l’écart de la conception des projets de rénovation urbaine. Le déficit participatif est partout criant, surtout si l’on compare avec les opérations de rénovation urbaine menées dans les villes américaines, britanniques ou allemandes. Pour les pistes, il faut lire le rapport remis par Marie-Hèlene Bacqué et Mohammed Mechmache à François Lamy, Pour une réforme radicale de la politique de la ville. Ça ne se fera plus sans nous en juillet 2013.